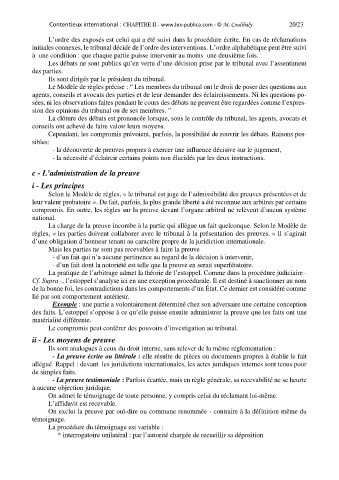Page 20 - chapitre_2_ctx_2021-2022
P. 20
Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 20/23
L’ordre des exposés est celui qui a été suivi dans la procédure écrite. En cas de réclamations
initiales connexes, le tribunal décide de l’ordre des interventions. L’ordre alphabétique peut être suivi
à une condition : que chaque partie puisse intervenir au moins une deuxième fois.
Les débats ne sont publics qu’en vertu d’une décision prise par le tribunal avec l’assentiment
des parties.
Ils sont dirigés par le président du tribunal.
Le Modèle de règles précise : “ Les membres du tribunal ont le droit de poser des questions aux
agents, conseils et avocats des parties et de leur demander des éclaircissements. Ni les questions po-
sées, ni les observations faites pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l’expres-
sion des opinions du tribunal ou de ses membres. ”
La clôture des débats est prononcée lorsque, sous le contrôle du tribunal, les agents, avocats et
conseils ont achevé de faire valoir leurs moyens.
Cependant, les compromis prévoient, parfois, la possibilité de rouvrir les débats. Raisons pos-
sibles:
- la découverte de preuves propres à exercer une influence décisive sur le jugement,
- la nécessité d’éclaircir certains points non élucidés par les deux instructions.
c - L’administration de la preuve
i - Les principes
Selon le Modèle de règles, « le tribunal est juge de l’admissibilité des preuves présentées et de
leur valeur probatoire ». De fait, parfois, la plus grande liberté a été reconnue aux arbitres par certains
compromis. En outre, les règles sur la preuve devant l’organe arbitral ne relèvent d’aucun système
national.
La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue un fait quelconque. Selon le Modèle de
règles, « les parties doivent collaborer avec le tribunal à la présentation des preuves. » Il s’agirait
d’une obligation d’honneur tenant au caractère propre de la juridiction internationale.
Mais les parties ne sont pas recevables à faire la preuve
- d’un fait qui n’a aucune pertinence au regard de la décision à intervenir,
- d’un fait dont la notoriété est telle que la preuve en serait superfétatoire.
La pratique de l’arbitrage admet la théorie de l’estoppel. Comme dans la procédure judiciaire -
Cf. Supra -, l’estoppel s’analyse ici en une exception procédurale. Il est destiné à sanctionner au nom
de la bonne foi, les contradictions dans les comportements d’un État. Ce dernier est considéré comme
lié par son comportement antérieur.
Exemple : une partie a volontairement déterminé chez son adversaire une certaine conception
des faits. L’estoppel s’oppose à ce qu’elle puisse ensuite administrer la preuve que les faits ont une
matérialité différente.
Le compromis peut conférer des pouvoirs d’investigation au tribunal.
ii - Les moyens de preuve
Ils sont analogues à ceux du droit interne, sans relever de la même réglementation :
- La preuve écrite ou littérale : elle résulte de pièces ou documents propres à établir le fait
allégué. Rappel : devant les juridictions internationales, les actes juridiques internes sont tenus pour
de simples faits.
- La preuve testimoniale : Parfois écartée, mais en règle générale, sa recevabilité ne se heurte
à aucune objection juridique.
On admet le témoignage de toute personne, y compris celui du réclamant lui-même.
L’affidavit est recevable.
On exclut la preuve par ouï-dire ou commune renommée - contraire à la définition même du
témoignage.
La procédure du témoignage est variable :
* interrogatoire unilatéral : par l’autorité chargée de recueillir sa déposition