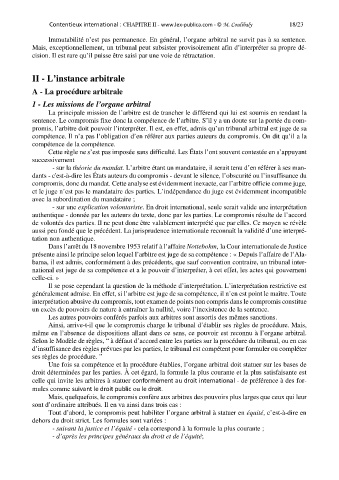Page 18 - chapitre_2_ctx_2021-2022
P. 18
Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 18/23
Immutabilité n’est pas permanence. En général, l’organe arbitral ne survit pas à sa sentence.
Mais, exceptionnellement, un tribunal peut subsister provisoirement afin d’interpréter sa propre dé-
cision. Il est rare qu’il puisse être saisi par une voie de rétractation.
II - L’instance arbitrale
A - La procédure arbitrale
1 - Les missions de l’organe arbitral
La principale mission de l’arbitre est de trancher le différend qui lui est soumis en rendant la
sentence. Le compromis fixe donc la compétence de l’arbitre. S’il y a un doute sur la portée du com-
promis, l’arbitre doit pouvoir l’interpréter. Il est, en effet, admis qu’un tribunal arbitral est juge de sa
compétence. Il n’a pas l’obligation d’en référer aux parties auteurs du compromis. On dit qu’il a la
compétence de la compétence.
Cette règle ne s’est pas imposée sans difficulté. Les États l’ont souvent contestée en s’appuyant
successivement
- sur la théorie du mandat. L’arbitre étant un mandataire, il serait tenu d’en référer à ses man-
dants - c'est-à-dire les États auteurs du compromis - devant le silence, l’obscurité ou l’insuffisance du
compromis, donc du mandat. Cette analyse est évidemment inexacte, car l’arbitre officie comme juge,
et le juge n’est pas le mandataire des parties. L’indépendance du juge est évidemment incompatible
avec la subordination du mandataire ;
- sur une explication volontariste. En droit international, seule serait valide une interprétation
authentique - donnée par les auteurs du texte, donc par les parties. Le compromis résulte de l’accord
de volontés des parties. Il ne peut donc être valablement interprété que par elles. Ce moyen se révèle
aussi peu fondé que le précédent. La jurisprudence internationale reconnaît la validité d’une interpré-
tation non authentique.
Dans l’arrêt du 18 novembre 1953 relatif à l’affaire Nottebohm, la Cour internationale de Justice
présente ainsi le principe selon lequel l’arbitre est juge de sa compétence : « Depuis l’affaire de l’Ala-
bama, il est admis, conformément à des précédents, que sauf convention contraire, un tribunal inter-
national est juge de sa compétence et a le pouvoir d’interpréter, à cet effet, les actes qui gouvernent
celle-ci. »
Il se pose cependant la question de la méthode d’interprétation. L’interprétation restrictive est
généralement admise. En effet, si l’arbitre est juge de sa compétence, il n’en est point le maître. Toute
interprétation abusive du compromis, tout examen de points non compris dans le compromis constitue
un excès de pouvoirs de nature à entraîner la nullité, voire l’inexistence de la sentence.
Les autres pouvoirs conférés parfois aux arbitres sont assortis des mêmes sanctions.
Ainsi, arrive-t-il que le compromis charge le tribunal d’établir ses règles de procédure. Mais,
même en l’absence de dispositions allant dans ce sens, ce pouvoir est reconnu à l’organe arbitral.
Selon le Modèle de règles, “ à défaut d’accord entre les parties sur la procédure du tribunal, ou en cas
d’insuffisance des règles prévues par les parties, le tribunal est compétent pour formuler ou compléter
ses règles de procédure. ”
Une fois sa compétence et la procédure établies, l’organe arbitral doit statuer sur les bases de
droit déterminées par les parties. À cet égard, la formule la plus courante et la plus satisfaisante est
celle qui invite les arbitres à statuer conformément au droit international - de préférence à des for-
mules comme suivant le droit public ou le droit.
Mais, quelquefois, le compromis confère aux arbitres des pouvoirs plus larges que ceux qui leur
sont d’ordinaire attribués. Il en va ainsi dans trois cas :
Tout d’abord, le compromis peut habiliter l’organe arbitral à statuer en équité, c’est-à-dire en
dehors du droit strict. Les formules sont variées :
- suivant la justice et l’équité - cela correspond à la formule la plus courante ;
- d’après les principes généraux du droit et de l’équité;