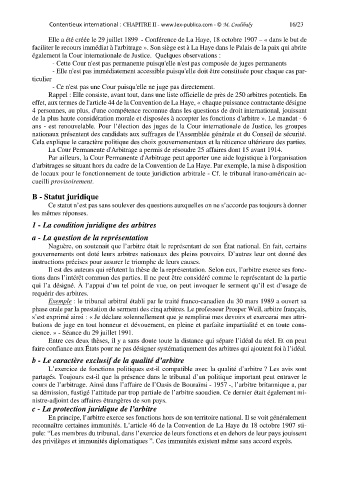Page 16 - chapitre_2_ctx_2021-2022
P. 16
Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 16/23
Elle a été créée le 29 juillet 1899 - Conférence de La Haye, 18 octobre 1907 – « dans le but de
faciliter le recours immédiat à l'arbitrage ». Son siège est à La Haye dans le Palais de la paix qui abrite
également la Cour internationale de Justice. Quelques observations :
- Cette Cour n'est pas permanente puisqu'elle n'est pas composée de juges permanents
- Elle n'est pas immédiatement accessible puisqu'elle doit être constituée pour chaque cas par-
ticulier
- Ce n'est pas une Cour puisqu'elle ne juge pas directement.
Rappel : Elle consiste, avant tout, dans une liste officielle de près de 250 arbitres potentiels. En
effet, aux termes de l'article 44 de la Convention de La Haye, « chaque puissance contractante désigne
4 personnes, au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant
de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitre ». Le mandat - 6
ans - est renouvelable. Pour l’élection des juges de la Cour internationale de Justice, les groupes
nationaux présentent des candidats aux suffrages de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité.
Cela explique le caractère politique des choix gouvernementaux et la réticence ultérieure des parties.
La Cour Permanente d'Arbitrage a permis de résoudre 25 affaires dont 15 avant 1914.
Par ailleurs, la Cour Permanente d'Arbitrage peut apporter une aide logistique à l'organisation
d'arbitrages se situant hors du cadre de la Convention de La Haye. Par exemple, la mise à disposition
de locaux pour le fonctionnement de toute juridiction arbitrale - Cf. le tribunal irano-américain ac-
cueilli provisoirement.
B - Statut juridique
Ce statut n’est pas sans soulever des questions auxquelles on ne s’accorde pas toujours à donner
les mêmes réponses.
1 - La condition juridique des arbitres
a - La question de la représentation
Naguère, on soutenait que l’arbitre était le représentant de son État national. En fait, certains
gouvernements ont doté leurs arbitres nationaux des pleins pouvoirs. D’autres leur ont donné des
instructions précises pour assurer le triomphe de leurs causes.
Il est des auteurs qui réfutent la thèse de la représentation. Selon eux, l’arbitre exerce ses fonc-
tions dans l’intérêt commun des parties. Il ne peut être considéré comme le représentant de la partie
qui l’a désigné. À l’appui d’un tel point de vue, on peut invoquer le serment qu’il est d’usage de
requérir des arbitres.
Exemple : le tribunal arbitral établi par le traité franco-canadien du 30 mars 1989 a ouvert sa
phase orale par la prestation de serment des cinq arbitres. Le professeur Prosper Weil, arbitre français,
s’est exprimé ainsi : « Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attri-
butions de juge en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute cons-
cience. » - Séance du 29 juillet 1991.
Entre ces deux thèses, il y a sans doute toute la distance qui sépare l’idéal du réel. Et on peut
faire confiance aux États pour ne pas désigner systématiquement des arbitres qui ajoutent foi à l’idéal.
b - Le caractère exclusif de la qualité d’arbitre
L’exercice de fonctions politiques est-il compatible avec la qualité d’arbitre ? Les avis sont
partagés. Toujours est-il que la présence dans le tribunal d’un politique important peut entraver le
cours de l’arbitrage. Ainsi dans l’affaire de l’Oasis de Bouraïmi - 1957 -, l’arbitre britannique a, par
sa démission, fustigé l’attitude par trop partiale de l’arbitre saoudien. Ce dernier était également mi-
nistre-adjoint des affaires étrangères de son pays.
c - La protection juridique de l’arbitre
En principe, l’arbitre exerce ses fonctions hors de son territoire national. Il se voit généralement
reconnaître certaines immunités. L’article 46 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 sti-
pule: “Les membres du tribunal, dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays jouissent
des privilèges et immunités diplomatiques ”. Ces immunités existent même sans accord exprès.