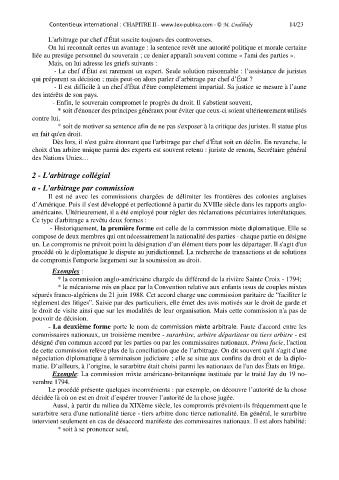Page 14 - chapitre_2_ctx_2021-2022
P. 14
Contentieux international : CHAPITRE II - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 14/23
L'arbitrage par chef d'État suscite toujours des controverses.
On lui reconnaît certes un avantage : la sentence revêt une autorité politique et morale certaine
liée au prestige personnel du souverain ; ce denier apparaît souvent comme « l'ami des parties ».
Mais, on lui adresse les griefs suivants :
- Le chef d'État est rarement un expert. Seule solution raisonnable : l’assistance de juristes
qui préparent sa décision ; mais peut-on alors parler d’arbitrage par chef d’État ?
- Il est difficile à un chef d'État d'être complètement impartial. Sa justice se mesure à l’aune
des intérêts de son pays.
- Enfin, le souverain compromet le progrès du droit. Il s'abstient souvent,
* soit d'énoncer des principes généraux pour éviter que ceux-ci soient ultérieurement utilisés
contre lui,
* soit de motiver sa sentence afin de ne pas s'exposer à la critique des juristes. Il statue plus
en fait qu'en droit.
Dès lors, il n'est guère étonnant que l'arbitrage par chef d'État soit en déclin. En revanche, le
choix d'un arbitre unique parmi des experts est souvent retenu : juriste de renom, Secrétaire général
des Nations Unies…
2 - L’arbitrage collégial
a - L’arbitrage par commission
Il est né avec les commissions chargées de délimiter les frontières des colonies anglaises
d’Amérique. Puis il s'est développé et perfectionné à partir du XVIIIe siècle dans les rapports anglo-
américains. Ultérieurement, il a été employé pour régler des réclamations pécuniaires interétatiques.
Ce type d'arbitrage a revêtu deux formes :
- Historiquement, la première forme est celle de la commission mixte diplomatique. Elle se
compose de deux membres qui ont nécessairement la nationalité des parties - chaque partie en désigne
un. Le compromis ne prévoit point la désignation d’un élément tiers pour les départager. Il s'agit d'un
procédé où le diplomatique le dispute au juridictionnel. La recherche de transactions et de solutions
de compromis l'emporte largement sur la soumission au droit.
Exemples :
* la commission anglo-américaine chargée du différend de la rivière Sainte Croix - 1794;
* le mécanisme mis en place par la Convention relative aux enfants issus de couples mixtes
séparés franco-algériens du 21 juin 1988. Cet accord charge une commission paritaire de “faciliter le
règlement des litiges”. Saisie par des particuliers, elle émet des avis motivés sur le droit de garde et
le droit de visite ainsi que sur les modalités de leur organisation. Mais cette commission n'a pas de
pouvoir de décision.
- La deuxième forme porte le nom de commission mixte arbitrale. Faute d'accord entre les
commissaires nationaux, un troisième membre - surarbitre, arbitre départiteur ou tiers arbitre - est
désigné d'un commun accord par les parties ou par les commissaires nationaux. Prima facie, l'action
de cette commission relève plus de la conciliation que de l’arbitrage. On dit souvent qu'il s'agit d'une
négociation diplomatique à terminaison judiciaire ; elle se situe aux confins du droit et de la diplo-
matie. D’ailleurs, à l’origine, le surarbitre était choisi parmi les nationaux de l'un des États en litige.
Exemple: La commission mixte américano-britannique instituée par le traité Jay du 19 no-
vembre 1794.
Le procédé présente quelques inconvénients : par exemple, on découvre l’autorité de la chose
décidée là où on est en droit d’espérer trouver l’autorité de la chose jugée.
Aussi, à partir du milieu du XIXème siècle, les compromis prévoient-ils fréquemment que le
surarbitre sera d'une nationalité tierce - tiers arbitre donc tierce nationalité. En général, le surarbitre
intervient seulement en cas de désaccord manifeste des commissaires nationaux. Il est alors habilité:
* soit à se prononcer seul,