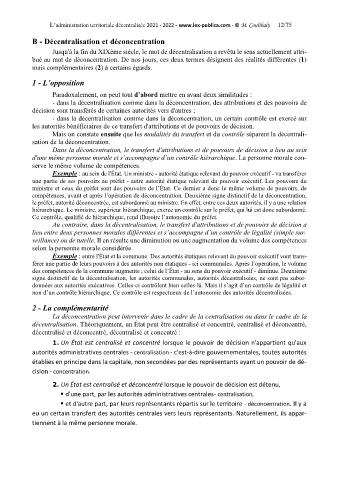Page 12 - adminloc_dag_2021-2022
P. 12
L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 12/75
B - Décentralisation et déconcentration
Jusqu'à la fin du XIXème siècle, le mot de décentralisation a revêtu le sens actuellement attri-
bué au mot de déconcentration. De nos jours, ces deux termes désignent des réalités différentes (1)
mais complémentaires (2) à certains égards.
1 - L’opposition
Paradoxalement, on peut tout d’abord mettre en avant deux similitudes :
- dans la décentralisation comme dans la déconcentration, des attributions et des pouvoirs de
décision sont transférés de certaines autorités vers d'autres ;
- dans la décentralisation comme dans la déconcentration, un certain contrôle est exercé sur
les autorités bénéficiaires de ce transfert d'attributions et de pouvoirs de décision.
Mais on constate ensuite que les modalités du transfert et du contrôle séparent la décentrali-
sation de la déconcentration.
Dans la déconcentration, le transfert d'attributions et de pouvoirs de décision a lieu au sein
d'une même personne morale et s’accompagne d’un contrôle hiérarchique. La personne morale con-
serve le même volume de compétences.
Exemple : au sein de l'État. Un ministre - autorité étatique relevant du pouvoir exécutif - va transférer
une partie de ses pouvoirs au préfet - autre autorité étatique relevant du pouvoir exécutif. Les pouvoirs du
ministre et ceux du préfet sont des pouvoirs de l’État. Ce dernier a donc le même volume de pouvoirs, de
compétences, avant et après l’opération de déconcentration. Deuxième signe distinctif de la déconcentration,
le préfet, autorité déconcentrée, est subordonné au ministre. En effet, entre ces deux autorités, il y a une relation
hiérarchique. Le ministre, supérieur hiérarchique, exerce un contrôle sur le préfet, qui lui est donc subordonné.
Ce contrôle, qualifié de hiérarchique, rend illusoire l’autonomie du préfet.
Au contraire, dans la décentralisation, le transfert d'attributions et de pouvoirs de décision a
lieu entre deux personnes morales différentes et s’accompagne d’un contrôle de légalité (simple sur-
veillance) ou de tutelle. Il en résulte une diminution ou une augmentation du volume des compétences
selon la personne morale considérée.
Exemple : entre l'État et la commune. Des autorités étatiques relevant du pouvoir exécutif vont trans-
férer une partie de leurs pouvoirs à des autorités non étatiques - ici communales. Après l’opération, le volume
des compétences de la commune augmente ; celui de l’État - au sens du pouvoir exécutif - diminue. Deuxième
signe distinctif de la décentralisation, les autorités communales, autorités décentralisées, ne sont pas subor-
données aux autorités exécutives. Celles-ci contrôlent bien celles-là. Mais il s’agit d’un contrôle de légalité et
non d’un contrôle hiérarchique. Ce contrôle est respectueux de l’autonomie des autorités décentralisées.
2 - La complémentarité
La déconcentration peut intervenir dans le cadre de la centralisation ou dans le cadre de la
décentralisation. Théoriquement, un État peut être centralisé et concentré, centralisé et déconcentré,
décentralisé et déconcentré, décentralisé et concentré :
1. Un État est centralisé et concentré lorsque le pouvoir de décision n'appartient qu'aux
autorités administratives centrales - centralisation - c'est-à-dire gouvernementales, toutes autorités
établies en principe dans la capitale, non secondées par des représentants ayant un pouvoir de dé-
cision - concentration.
2. Un État est centralisé et déconcentré lorsque le pouvoir de décision est détenu,
d'une part, par les autorités administratives centrales- centralisation,
et d'autre part, par leurs représentants répartis sur le territoire - déconcentration. Il y a
eu un certain transfert des autorités centrales vers leurs représentants. Naturellement, ils appar-
tiennent à la même personne morale.