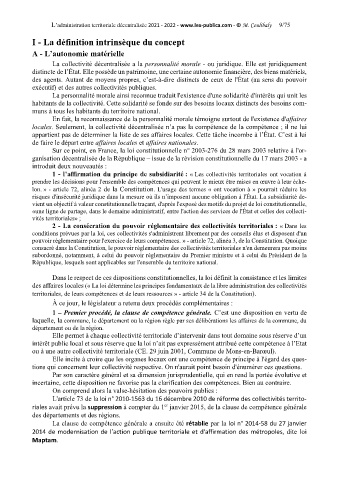Page 9 - adminloc_dag_2021-2022
P. 9
L’administration territoriale décentralisée 2021 - 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 9/75
I - La définition intrinsèque du concept
A - L’autonomie matérielle
La collectivité décentralisée a la personnalité morale - ou juridique. Elle est juridiquement
distincte de l’État. Elle possède un patrimoine, une certaine autonomie financière, des biens matériels,
des agents. Autant de moyens propres, c’est-à-dire distincts de ceux de l'État (au sens du pouvoir
exécutif) et des autres collectivités publiques.
La personnalité morale ainsi reconnue traduit l'existence d'une solidarité d'intérêts qui unit les
habitants de la collectivité. Cette solidarité se fonde sur des besoins locaux distincts des besoins com-
muns à tous les habitants du territoire national.
En fait, la reconnaissance de la personnalité morale témoigne surtout de l'existence d'affaires
locales. Seulement, la collectivité décentralisée n’a pas la compétence de la compétence ; il ne lui
appartient pas de déterminer la liste de ses affaires locales. Cette tâche incombe à l’État. C’est à lui
de faire le départ entre affaires locales et affaires nationales.
Sur ce point, en France, la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'or-
ganisation décentralisée de la République – issue de la révision constitutionnelle du 17 mars 2003 - a
introduit deux nouveautés :
1 - l’affirmation du principe de subsidiarité : « Les collectivités territoriales ont vocation à
prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur éche-
lon. » - article 72, alinéa 2 de la Constitution. L'usage des termes « ont vocation à » pourrait réduire les
risques d'insécurité juridique dans la mesure où ils n’imposent aucune obligation à l'État. La subsidiarité de-
vient un objectif à valeur constitutionnelle traçant, d'après l'exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle,
«une ligne de partage, dans le domaine administratif, entre l'action des services de l'État et celles des collecti-
vités territoriales» ;
2 - La consécration du pouvoir réglementaire des collectivités territoriales : « Dans les
conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un
pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » - article 72, alinéa 3, de la Constitution. Quoique
consacré dans la Constitution, le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales n'en demeurera pas moins
subordonné, notamment, à celui du pouvoir réglementaire du Premier ministre et à celui du Président de la
République, lesquels sont applicables sur l'ensemble du territoire national.
*
Dans le respect de ces dispositions constitutionnelles, la loi définit la consistance et les limites
des affaires locales (« La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités
territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » - article 34 de la Constitution).
À ce jour, le législateur a retenu deux procédés complémentaires :
1 – Premier procédé, la clause de compétence générale. C’est une disposition en vertu de
laquelle, la commune, le département ou la région règle par ses délibérations les affaires de la commune, du
département ou de la région.
Elle permet à chaque collectivité territoriale d’intervenir dans tout domaine sous réserve d’un
intérêt public local et sous réserve que la loi n’ait pas expressément attribué cette compétence à l’Etat
ou à une autre collectivité territoriale (CE. 29 juin 2001, Commune de Mons-en-Barœul).
Elle incite à croire que les organes locaux ont une compétence de principe à l'égard des ques-
tions qui concernent leur collectivité respective. On n'aurait point besoin d'énumérer ces questions.
Par son caractère général et sa dimension jurisprudentielle, qui en rend la portée évolutive et
incertaine, cette disposition ne favorise pas la clarification des compétences. Bien au contraire.
On comprend alors la valse-hésitation des pouvoirs publics :
L'article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territo-
er
riales avait prévu la suppression à compter du 1 janvier 2015, de la clause de compétence générale
des départements et des régions.
La clause de compétence générale a ensuite été rétablie par la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi
Maptam.